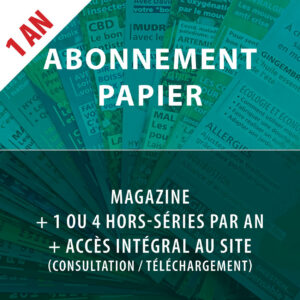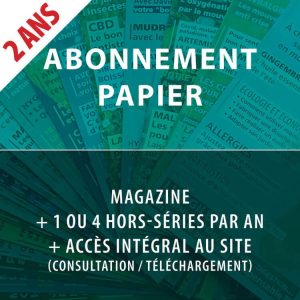Rob Hopkins, le pouvoir d’agir ensemble

Cet homme a lancé le mouvement des Villes en Transition qui s’étend désormais largement en dehors de son Angleterre natale. Il a donné naissance à des milliers de projets, portés par des petits groupes, pour des actions locales, durables, et très humaines.
Rob Hopkins est un condensé d’humanité. Regard lumineux, sourire rayonnant, il parle calmement avec le souci de bien se faire comprendre, s’émerveillant toujours de voir ce que les gens sont capables de faire lorsqu’ils se mettent ensemble. À l’écouter, on ne peut qu’être touché par toutes ces aventures collectives.
Un projet de collégiens
Alors qu’il était professeur de permaculture, il y a 10 ans, Rob prend davantage conscience des problèmes de réchauffement climatique, d’énergie et d’autonomie. Il demande alors à un groupe de collégiens de travailler sur un projet pour imaginer une ville qui serait libérée de sa dépendance au pétrole. Les élèves jettent ainsi les bases du mouvement Villes en Transition qu’il appliquera très vite dans sa petite ville de Totnes dans le Devon (Angleterre).
Moins de constats, plus de solutions
La force de ce concept est de ne pas s’attacher au constat, mais de se concentrer sur les solutions possibles, même en commençant « petit ». Avec une poignée de gens motivés et concernés, il s’agit de voir quelles actions pourraient changer le quotidien local. Que ce soit pour l’agriculture, la nourriture, les déchets, l’énergie, les transports ou l’économie. Peu importe le thème, pourvu que cela apporte de la résilience (terme qu’affectionne Rob), c’est-à-dire dépenser moins de ressources, respecter plus la planète et surtout créer plus d’humanité.
Autre particularité de ce mouvement : il s’agit d’activer autant la transition intérieure qu’extérieure. C’est un point essentiel, car trop de mouvements associatifs ou collectifs ont buté devant la difficulté de résoudre les conflits nés des différences individuelles. Le réseau de Transition propose des soutiens psychologiques, du coaching et des formations à la gestion de groupe, décuplant ses chances de cohésion et de réussite.
Un réseau créatif
Présent aujourd’hui dans 50 pays, avec plus de 2000 projets, dont 150 en France, le mouvement agit certes sur des questions concrètes du quotidien, mais c’est aussi devenu un mouvement culturel et créatif. C’est une façon de réinventer l’avenir, de reprendre en main son pouvoir d’agir et surtout de le faire ensemble, avec les gens de son quartier, de son village. Une sorte de réseau social, mais dans la vraie vie ! Et quand l’énergie (humaine) est là, il n’y a pratiquement plus de limites. Des communautés en Transition ont créé leur propre entreprise d’énergie, leurs exploitations agricoles, leurs commerces et certaines ont même battu leurs propres monnaies : symbole fort de l’autonomie d’une collectivité locale.
Nous avons rencontré Rob Hopkins à Paris, en marge de la COP21 où il venait présenter son livre 21 histoires de Transition (livre qui porte volontairement la mention « pas en vente sur Amazon »). Il y était présent également à travers le documentaire de Cyril Dion, Demain, projeté à l’ouverture de la conférence. Entretien.
Rebelle-Santé : Quelles sont les valeurs portées par le mouvement ?
Rob Hopkins : La compassion. La Transition est conçue pour trouver des solutions venant de chacun pour apprendre à travailler ensemble. Il y a aussi la justice sociale, l’attention aux autres, le fait de se soutenir les uns les autres. On encourage la créativité et on favorise la positivité pour entrevoir de nouvelles possibilités.
Les projets touchent des domaines assez différents…
La Transition se focalise sur le fait de rendre des lieux ou des économies locales plus résilientes. Ça veut dire aussi rendre l’économie locale plus diversifiée et plus forte. Ces projets peuvent concerner l’énergie, la nourriture ou d’autres choses. Il y a autant de solutions concrètes que de personnes différentes. C’est conçu pour que chacun trouve sa place. Dans 9 villes, nous avons créé une entreprise de production d’énergie, on a des projets sur le transport, sur l’agriculture. Ils font tous partie d’une histoire et sont liés à la motivation des membres de la communauté.
Les enjeux de santé font-ils partie de la Transition ?
Il y a différentes façons pour la Transition d’avoir une stratégie de santé publique. Par exemple, nous avons engagé une réflexion sur ce que serait un hôpital de la Transition. Dans beaucoup de collectivités, l’hôpital est un des plus grands employeurs, un des plus grands consommateurs de nourriture et d’énergie. Les institutions ont beaucoup à gagner en collaborant avec les communautés locales. On pourrait ainsi améliorer l’aménagement des hôpitaux pour les rendre plus beaux et plus agréables, faire en sorte que l’économie de l’hôpital soit plus orientée sur la localité. Et bien sûr, améliorer la qualité de la nourriture, en créant notamment des potagers gérés en coopérative, etc.
Quelles sont les principales étapes pour démarrer un projet de Ville en Transition ?
D’abord, il faut des gens, car tout seul vous ne pouvez rien faire ! Il faut aussi du temps, des compétences à consacrer à cela. Ensuite, il faut organiser des évènements pour inviter plus de personnes à rejoindre le processus. Il y a beaucoup d’outils qui sont utilisés, des réunions, des rassemblements pour inviter les gens à donner des idées. On propose aussi des formations à la Transition pour aider les personnes à bien gérer un groupe. Une autre étape consiste à tisser des partenariats avec d’autres organisations en faisant des projets concrets qui favorisent ces rapprochements. Dans la Transition, on défend l’idée qu’on peut faire quelque chose face aux problèmes de réchauffement climatique. C’est très concret et immédiat : si tu veux démarrer un jardin, très bien ! Faisons-le samedi ou dimanche prochain. C’est un mouvement pour transformer les idées en actions.
Vous attachez beaucoup d’importance au fait de se retrouver, de fêter les choses…
C’est très important. Dans chaque réunion ou rassemblement, on a besoin de fêter quelque chose : des résultats d’actions ou le simple fait d’être là, ensemble. C’est très ancré dans le concept de la Transition. Les groupes de Transition font de belles fêtes et de bons gâteaux. (Rires !)
Vous avez fait un livre sur 21 histoires de Transition, pourquoi 21 ?
On voulait créer quelque chose, mais sans faire un document qui dise ce que les responsables doivent faire. La Transition est un mouvement dans lequel les gens lancent des projets sans attendre une quelconque autorisation. Nous voulions leur rendre hommage. On a donc demandé aux groupes dans 50 pays de nous raconter l’histoire de leurs projets, afin de les partager à l’occasion de la COP21. On a reçu beaucoup d’histoires et on en a choisi 21 issues de 15 pays différents. Mises toutes ensembles, ces histoires génèrent 17 millions d’euros d’investissement en énergies renouvelables, 1,31 million d’euros de monnaies locales en circulation et 18,5 milliers d’heures de travail bénévoles. On a créé ce livre pour montrer que les gens peuvent faire des choses remarquables. Les gouvernements devraient aider ces initiatives.
En voyant votre mouvement, on pense au mouvement Colibris de Pierre Rabhi…
Il y a des similarités. Cependant, une des différences est la Transition intérieure. Nos groupes ont acquis les compétences pour travailler ensemble. On se concentre beaucoup sur cet aspect, plus que n’importe quel autre mouvement. Il y a aussi ce qu’on appelle la ré-économie. La plupart des personnes dans les groupes sont bénévoles et la ré-économie consiste à lancer une activité pour créer des emplois pour ces personnes. Cela entraîne ces groupes à fonctionner davantage avec un esprit d’entreprise.
Comment cela fonctionne ?
Nous créons des rencontres qui permettent de lancer et d’aider de nouveaux projets. Nous l’avons fait plusieurs fois dans ma ville, Totnes. Les gens qui ont une idée d’activité viennent la présenter à la communauté, devant 300 personnes. Chacune de ces personnes est un investisseur potentiel dans cette économie. Chaque candidat précise ses besoins financiers pour démarrer. Par exemple, « Je veux fabriquer et vendre des gâteaux et j’ai besoin de 4000 euros pour démarrer et d’un local pour cuisiner« . Alors les gens répondent : « J’ai 100 euros à investir » ou « 1000 euros« , « J’ai un local à te proposer » ou « Je peux faire gratuitement un site web« , etc. En faisant 4 fois cet événement, nous avons récolté près de 92 000 euros d’investissement et 20 activités se sont lancées.
Vous avez même créé une brasserie !
Oui, nous avons trouvé un investisseur pour ce projet et maintenant la brasserie marche très bien. Chaque année, l’équipe de la brasserie vient aux rencontres. Elle choisit un projet qui y est présenté pour le soutenir tout au long de l’année. Chaque projet qui a été aidé va ensuite en aider d’autres. Avec ce système, on renforce l’économie locale.
Vous développez aussi l’économie locale et circulaire, de quelle façon ?
C’est ce qu’on appelle le « Blue print » économique. Cela consiste à évaluer l’argent dépensé chaque année dans un domaine pour savoir où va l’argent : dans des grandes entreprises ou dans des petites boutiques locales. Dans notre ville, Totnes, nous dépensons 30 millions de livres (près de 40 millions d’euros) en nourriture chaque année. Sur cette somme, 22 millions (près de 29 millions d’euros) partent dans les supermarchés, donc sortent de la ville. L’idée est de se dire qu’on peut consacrer 10 % de notre dépense de nourriture à l’économie locale : ça injecterait plus de 2 millions de livres dans notre économie. Et vous pouvez appliquer le même principe à l’énergie, la construction, etc. Cela fait naître cette économie circulaire. Pour moi, c’est le nouveau modèle.
Plus d’infos : www.entransition.fr et www.transitionnetwork.org
À LIRE, À VOIR
21 histoires de Transition, récoltées par Rob Hopkins. En auto édition.
Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant. Rob Hopkins, Lionel Astruc, Actes Sud.
Demain (le DVD), documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Demain (le livre). Cyril Dion, Actes Sud / Colibris.