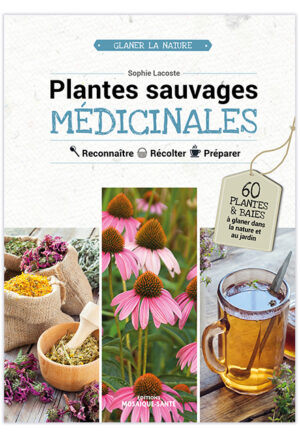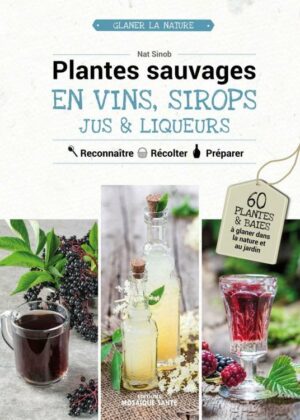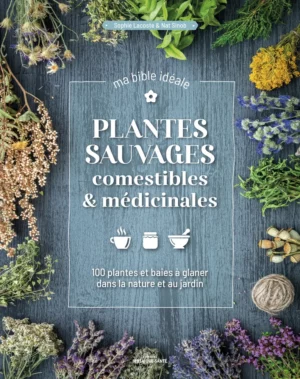Redécouvrez les plantes sauvages pour la santé et le goût !

Nos grands-parents connaissaient les vertus des plantes sauvages. Ils concoctaient de délicieux petits plats avec des orties, du pissenlit ou encore de l’ail des ours. Pourquoi ne ferions-nous pas comme eux ? Profitons d’une balade en famille, par exemple, pour partir à la cueillette et découvrir ces trésors que la nature nous offre gratuitement.
Habituées à pousser librement, sans l’aide de l’Homme et des fertilisants, les plantes sauvages ont développé leurs propres défenses contre les insectes et les prédateurs. Considérées à tort comme des mauvaises herbes, elles sont pourtant souvent bien plus concentrées en principes actifs bénéfiques à la santé que les légumes que nous consommons habituellement. Une bonne raison de les regarder d’un œil différent et de les … goûter.
L’ortie (Urtica dioica)
Elle pique quand on la touche mais, une fois cuite, l’ortie fait un délicieux légume au goût proche des épinards. Rassurez-vous, aucun risque de piqûre en bouche ! L’ortie est très riche en chlorophylle et en flavonoïdes. Elle contient une importante quantité de fer, ce qui la rend particulièrement intéressante pour les femmes, souvent carencées en fer. Elle contient également du magnésium, du potassium, du calcium, du soufre, du zinc, du manganèse, du silicium, des vitamines B et C, et de la provitamine A. Elle a des vertus anti-inflammatoires, dépuratives et détoxifiantes. Pas mal pour une « mauvaise herbe », n’est-ce pas !
En raison de sa richesse en principes actifs, l’ortie est un bon tonique général. Elle est recommandée en cas d’anémie, de convalescence, de déminéralisation, mais aussi pour lutter contre les allergies, les problèmes cutanés et digestifs.

- L’ortie est délicieuse en potage, quiche, gratin, lasagnes… De manière générale, les orties peuvent remplacer les épinards dans n’importe quelle recette. Mais elles sont également délicieuses en version sucrée, par exemple en gelée ou confiture.
Le pissenlit (Taraxacum officinale)
Le pissenlit, qui pousse dans tous les jardins, est le grand ami du foie. Il stimule la production de bile. Il est tonique, diurétique et dépuratif sanguin. Il est également riche en vitamines A, C et K.

- Les feuilles se consomment en salade ou encore en soupe. Avec les fleurs, on peut fabriquer du vin. Attention, le pissenlit, comme de nombreuses plantes bénéfiques pour le foie, a un goût très amer qui est loin de faire l’unanimité. Les feuilles de pissenlit sont donc à ajouter à vos plats avec parcimonie. Bien utilisée, cette amertume relèvera subtilement vos plats tels que des potages ou des salades.
Le plantain (Plantago var. major, media et lanceolata)
Le plantain est une plante sauvage qui s’invite régulièrement dans les champs ou les jardins. Ses feuilles poussent en touffe à partir du sol. Le plantain produit une multitude de graines, ce qui peut le rendre très envahissant.
Il existe plusieurs variétés de plantain dont 3 s’utilisent en cuisine, le grand plantain (Plantago major), le plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et le plantain moyen (Plantago media).
Riche en mucilages adoucissants et anti-inflammatoires, le plantain est recommandé contre la toux et les troubles bronchiques. On le préconise aussi en cas d’asthme bronchique en raison de ses propriétés anti-allergiques et antispasmodiques. Il purifie les poumons, l’estomac et le sang. Il contient également beaucoup de calcium, de la vitamine C et du bétacarotène, ainsi que des tanins et des flavonoïdes antioxydants.

- Les jeunes feuilles se mangent en salade. Les autres s’accommodent comme des légumes en accompagnement, en potage ou encore en sauce. La feuille de plantain a un goût qui rappelle un peu celui des champignons.
Le pourpier (Portulaca oleracea)
Le pourpier est la plante vedette du régime crétois de par sa richesse en acides gras de type Oméga 3. C’est l’un des facteurs qui expliquerait la longévité des Crétois.
Ce pourpier sauvage que vous pourrez cueillir de juin à août, est très riche en Oméga 3, bourré d’antioxydants, et a une teneur intéressante en fer, calcium, magnésium et potassium, ainsi qu’en vitamines E, A, C et B. Il est émollient et diurétique.

- Cette petite plante rampante, aux feuilles vertes charnues et croquantes et aux tiges rosées, se consomme le plus souvent crue mais rien ne vous empêche de la consommer cuite si vous le souhaitez, en beignets, en farce ou en potage, par exemple. Les feuilles et les petites tiges fines sont absolument délicieuses en salade. Leur goût est acidulé, un brin citronné, légèrement poivré.
La salicorne (Salicornia europaea)
Délicieuse salicorne au goût raffiné, servie par les plus grands chefs… Cette petite plante grasse herbacée annuelle se ramasse de mai à fin août. Elle se développe sur les sols riches en sel des marais salants comme ceux de la Baie de Somme, de la Charente-Maritime, de la Bretagne…
La salicorne est peu calorique et riche en minéraux dont iode, potassium, phosphore, fer, zinc, manganèse, magnésium, silice, ainsi qu’en vitamine C, du bétacarotène, des acides gras Oméga 3 et beaucoup de chlorophylle.
Elle a des propriétés toniques, dépuratives et diurétiques. Très riche en sel, elle est cependant déconseillée aux personnes soumises à un régime faible en sodium.

- Seule la salicorne annuelle est consommée, la variété vivace est trop coriace. Elle ressemble un peu à un haricot fin et croquant. Son goût est salé, iodé. La salicorne se prépare habituellement comme un légume. Délicieuse, elle se suffit à elle-même, juste avec une noisette de beurre, et n’a pas besoin d’être accommodée de manière compliquée.
L’ail des ours (Allium ursinum)
Je raffole de l’ail des ours. Cet ail sauvage pousse dans les sous-bois. Ses feuilles ressemblent aux feuilles du muguet (très toxiques !) mais, froissées entre les doigts, elles dégagent une forte odeur d’ail. L’ail des ours, à sa floraison au printemps, se pare de jolies fleurs blanches en ombelles à 6 pétales longs et fins.
Comme l’ail cultivé, l’ail des ours est fortement antibactérien, anti-infectieux, vermifuge, anticancer, antithrombotique, hypotensif, dépuratif et antiseptique. Associé à la coriandre, c’est un bon chélateur des métaux lourds. La concentration en principes actifs de l’ail des ours est encore plus importante que celle de son petit frère cultivé, ce qui n’est pas peu dire. Il est par ailleurs exceptionnellement riche en vitamine C.

- On consomme ses feuilles en salade, comme condiment, ajouté à du fromage blanc, en pesto… Les idées ne manquent pas. En automne, on peut également consommer ses bulbes. Son goût est celui de l’ail en moins prononcé.
Le chénopode bon-Henri (Chenopodium bonus-henricus)
Le chénopode bon-Henri pousse sur des sols caillouteux aux abords des chemins, au pied des murets…
Le chénopode est adoucissant, vermifuge, dépuratif et légèrement laxatif. Il soulage les maux d’estomac. Riche en acide oxalique, il est à éviter chez les arthritiques, ou si vous souffrez de troubles rénaux ou hépatiques.

- Il est aussi appelé épinard sauvage et se prépare comme ce dernier, en lasagne, en soupe, en accompagnement et même en salade pour les toutes jeunes feuilles. Ses feuilles en forme de hallebarde doivent être consommées jeunes, sinon elles deviennent un peu coriaces et âcres.
L’oseille (Rumex acetosa)
L’oseille sauvage est une plante vivace très rustique qui peut atteindre quasi 1 mètre de haut. Ses feuilles en forme de lance se couvrent au printemps et en été de petites fleurs roses en épis. On la trouve souvent dans les prairies et les clairières des forêts.
L’oseille est très riche en caroténoïdes antioxydants. Elle fournit de la vitamine C, E, du magnésium, du fer, du zinc et du cuivre. Elle contient aussi une quantité appréciable d’acide linoléique, un acide gras polyinsaturé de la famille des Oméga 6. Elle ouvre l’appétit et stimule la digestion. Riche en acide oxalique, l’oseille doit cependant être consommée avec parcimonie si vous souffrez des reins, du foie ou de troubles articulaires.

- Ses feuilles ont une saveur acidulée légèrement citronnée. Elles se récoltent avant la floraison et se consomment principalement en salade ou en soupe. Mais on peut aussi en faire du pesto ou des sauces.
POUR EN SAVOIR PLUS
La cuisine des plantes sauvages : 130 recettes simples à réaliser avec les plantes de nos campagnes, de Meret Bissegger, aux éditions Eugen Ulmer. 320 pages. 32 €
Je cuisine les plantes sauvages, d’Amandine Geers et Olivier Degorce, aux éditions Terre Vivante. 144 pages. 12 €
Cuisine sauvage. Accommoder mille plantes oubliées, de François Couplan, aux éditions Sang de la Terre. 638 pages. 37,90 €