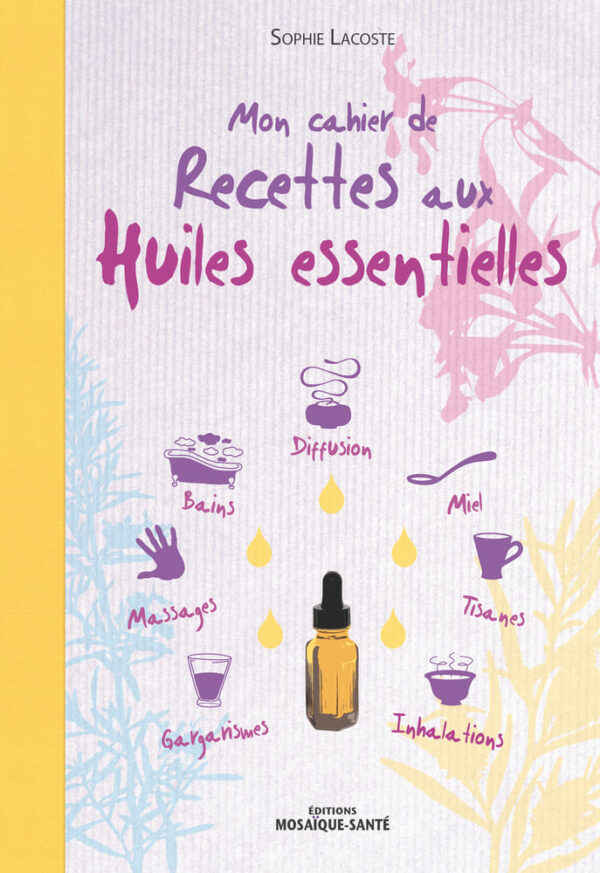Peau et soleil : le bon programme cosmétique

Notre peau entretient avec le soleil des rapports parfois heureux, parfois dangereux, toujours complexes et jamais anodins. Pour mieux lui résister, elle a développé des systèmes de réponses protecteurs spécifiques. Mais gare aux ravages en cas d’abus de bronzage.
Les défenses de la peau
L’épaississement de l’épiderme
C’est certainement la protection la plus efficace. On a ainsi observé que les personnes exposées de façon chronique au soleil (travailleurs en extérieur…), qui se sont « construit » une peau plus épaisse, développent moins de mélanomes que les personnes exposées de façon intermittente (vacanciers prenant le soleil trois semaines par an…).
Le bronzage
La couche basale de l’épiderme humain contient des mélanocytes, qui produisent des pigments appelés mélanines. Sous l’effet du soleil, on assiste à une activation de la synthèse de ces mélanines et à leur transfert vers les kératinocytes. La coloration de la peau qui en résulte, le bronzage, s’oppose à la pénétration des rayons UV dans l’épiderme. Mais ces défenses ne suffisent pas toujours, notamment pour faire face aux effets les plus nocifs du soleil.
Les dommages cutanés
Le vieillissement de la peau
L’élastose solaire, qui se traduit par une peau ayant perdu son élasticité et marquée de profonds sillons, peut mettre des années à se manifester, mais son processus est mis en marche dès la première exposition. Sous l’effet des UVA, le nombre des fibroblastes contenus dans le derme diminue. Peu à peu, leur capacité à fabriquer le collagène chute et les fibres d’élastine qu’ils synthétisent sont modifiées. L’élastose solaire résulte du dépôt d’élastine altérée dans les couches supérieures du derme. Elle est plus fréquente sur les zones chroniquement exposées (tête et cou), chez les personnes à peau claire, et augmente avec l’âge. C’est en fait la réponse à la dose cumulée d’UV absorbée.
Immunosuppression et cancers cutanés
L’exposition UV, aigüe à forte dose, ou chronique à faible dose, induit une immunosuppression locale et systémique, suivant des mécanismes complexes initiés par plusieurs photorécepteurs présents à la surface de la peau (ADN, acide trans-urocanique, constituants des membranes cellulaires…). Elle est également reconnue cancérogène pour l’Homme, provoquant des cancers cutanés non-mélanomes et des mélanomes, moins fréquents mais bien plus « méchants ».
En France, on recense environ 7500 cas par an, et 1512 décès.
Les cancers cutanés sont influencés par plusieurs facteurs. Ils sont ainsi plus fréquents dans les populations à peau claire, et les mélanomes sont plus nombreux quand les personnes ont été exposées pendant l’enfance. On observe aussi une répartition anatomique des mélanomes fortement liée aux zones exposées. Pas de doutes, ce sont bien nos comportements face au soleil qui induisent la recrudescence des cancers de la peau. Or, ils ont considérablement évolué dans le temps, et pas dans le bon sens.
Désir de bronzage, clé des ravages
Pendant des millénaires, depuis la préhistoire jusque dans les années 1930, les hommes se sont protégés du soleil.
Au XIXe siècle encore, on évitait soigneusement l’exposition solaire, et plus particulièrement si l’on était une femme appartenant à une classe sociale élevée. La relation entre soleil et cancer était encore inconnue, la motivation résidait dans le désir de conserver un teint pâle, signe d’aristocratie. Puis, les styles de vie ont changé, les vacances au soleil se sont développées et le bronzage est devenu synonyme de bien-être, de santé et de réussite sociale.
De plus, entre 1925 et 1930, on a découvert le rôle des UV dans la synthèse de la vitamine D. L’exposition solaire n’en est devenue que plus populaire et on a développé parallèlement les premières lampes UV utilisées en médecine préventive. L’exposition aux UV est devenue un objectif de santé publique, on recommandait d’exposer les enfants au soleil…
Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle qu’a été faite la relation entre UV, cancer et vieillissement cutané. Jusqu’à ce qu’en juin 2009, le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) classe les UV de 100 à 400 nm dans le Groupe 1 des cancérogènes avérés pour l’Homme.
La protection par les crèmes solaires : une question brûlante !
Mais pour renforcer les défenses de la peau face au soleil, ne dispose-t-on pas de crèmes solaires ? Sont-elles efficaces ? Aucune étude n’a montré de réduction du risque de cancers non-mélanomes associée à l’utilisation de crèmes solaires. Aucune n’a montré non plus de façon convaincante la réduction du risque de mélanome. Certaines ont même montré une augmentation du risque !
Prolongation des expositions
Le problème ne réside pas dans la réalité des indices de protection ou dans la qualité des produits, mais bien, une fois de plus, dans le comportement des utilisateurs. Lorsque l’exposition solaire est motivée par un désir de bronzage ou de rester plus longtemps au soleil, l’utilisation d’une crème solaire peut augmenter le temps passé au soleil de 13 à 39 %. Et donc l’exposition aux UV. Le comportement des utilisateurs de crèmes solaires leur ferait ainsi perdre tout leur intérêt.
Force de la prévention
Le problème n’est pourtant pas insoluble. En guise de preuve, l’exemple australien. Depuis 50 ans, l’Australie vit sous le régime des campagnes permanentes de prévention contre les risques liés au soleil. Les crèmes solaires y sont vendues au litre pour être moins chères, tout est fait pour favoriser leur utilisation. Les Australiens, bien informés et mieux éduqués, ne vont pas sur la plage sans avoir appliqué leur crème et savent se protéger.
En Europe, on utilise la crème pour s’exposer davantage…
Il est donc plus que temps de revoir nos modes de pensée. Le rayonnement ultraviolet reste la principale cause environnementale de cancer cutané et de mélanome, une tumeur qui contribue de façon disproportionnée aux taux de mortalité des jeunes adultes. Parce que oui, le mélanome est le cancer des jeunes. Et que quelques précautions suffisent pour l’éviter.