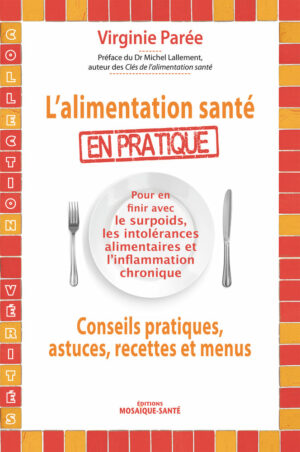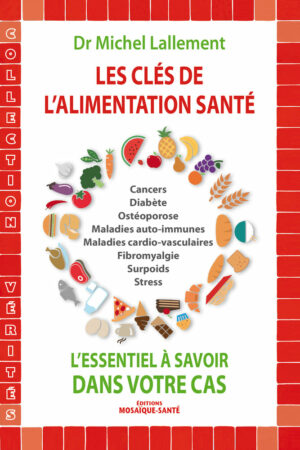Les piliers de la santé : l’alimentation

Notre physiologie, même si elle a évolué, reste globalement celle d’un humain du paléolithique. À ce titre, elle est adaptée à un régime de pêcheur-chasseur-cueilleur, variant selon les biotopes (zones géographiques, ndlr). Au menu de nos lointains ancêtres, on trouvait des racines, des tubercules, des graines, des fruits et des feuilles de végétaux sauvages. S’y ajoutaient des champignons, des œufs, de la chair et des abats de divers petits et grands animaux sauvages, du poisson, des coquillages et des crustacés en bord de mer. La caractéristique commune à tous ces aliments, c’est leur faible degré de transformation avant consommation.
Cuisson et fermentation
Les Homo erectus, heidelbergensis puis sapiens, de charognards opportunistes, sont devenus chasseurs et ont découvert le feu, il y a au moins 400 000 ans. Aux fermentations spontanées et aux séchages, s’est alors ajoutée une autre transformation : la cuisson. Cuire favorise la digestibilité de nombreux aliments, ce qui permet à la fois d’élargir le spectre de ressources utilisables et de faire économiser énormément d’énergie à l’organisme (pour l’assimilation des nutriments). L’amidon cru n’est digéré qu’à 12 % alors qu’il l’est à 35 % une fois cuit. Il en est de même pour les protéines, avec respectivement 45 % et 78 %. Cette énergie économisée par l’organisme est consacrée à d’autres tâches, comme les cognitions (apprentissage, mémoire, etc., ndlr) plutôt que pour la quête permanente de nourriture, la mastication et la digestion. Résultat : le tube digestif de l’humain moderne est beaucoup plus court (de près de 40 %) que celui des grands singes, qui consomment une grande quantité de végétaux crus. En revanche, le cerveau humain est beaucoup plus volumineux et consomme 20 % de l’énergie du corps (alors qu’il ne représente que 2 % de sa masse). La cuisson élimine aussi de nombreux germes pathogènes, en particulier bactéries et parasites. Quant à la fermentation, probablement pratiquée dès -13 000 (d’après les vestiges retrouvés sur le site natoufien de Raqefet en Israël), elle permet de conserver des aliments tels que légumes, lait, viandes et poissons. Elle dégrade aussi les facteurs antinutritionnels (phytates, hémagglutinines) de certains aliments comme les céréales complètes et les légumineuses, et améliore ainsi leur qualité nutritionnelle.
Les facteurs antinutritionnels sont des composés chimiques qui nuisent à l’absorption des nutriments et des micronutriments.
Du néolithique au XXe siècle
La stratification sociale du Néolithique et l’avènement de l’agriculture aboutissent à une alimentation beaucoup moins diversifiée où les glucides se taillent une part croissante sous la forme de produits céréaliers qui ont l’immense avantage économique d’être faciles à stocker. On voit ainsi apparaître des carences micronutritionnelles (en vitamines, minéraux, antioxydants, etc.) et des déséquilibres nutritionnels (carences en protéines, en particulier) chez les plus pauvres, cependant que les plus aisés, qui mangent trop, découvrent les maladies métaboliques. Le diabète, l’obésité, la goutte – et les maladies cardio-vasculaires qui les accompagnent – deviennent des marqueurs de réussite sociale.
Les transformations des aliments resteront alors, pendant des siècles, la cuisson, la fermentation, le fractionnement (purées, poudres, etc.), mais il n’y a toujours à ce stade aucun aliment ultra-transformé.
Pour lire la suite
Fondé en 1998 par Sophie Lacoste, journaliste passionnée par les plantes et leurs bienfaits, Rebelle-Santé est un magazine totalement indépendant. Chaque article est soigneusement rédigé par humain spécialisé dans le sujet. Rebelle-Santé ne pratique pas la publicité déguisée.
En vous abonnant, vous recevrez chez vous 10 numéros par an et 1 à 4 hors-séries. Vous aurez également accès à plus de 11 000 articles et à 45 nouveaux articles chaque mois.
Comme tout média indépendant, Rebelle-Santé a besoin de vos abonnements pour continuer à exister.
Déjà abonné·e ?