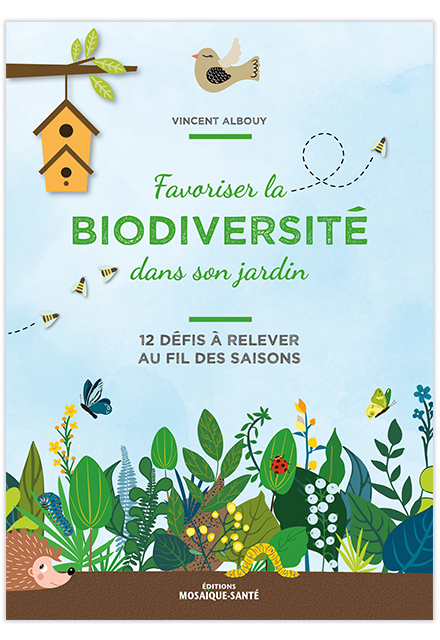Découvrez et plantez la biodiversité fruitière !

Cet automne, jouez la carte de la biodiversité fruitière : adoptez les fruits sauvages ou les fruits oubliés, faciles à cultiver, en haie ou en verger.
Les fruits sauvages, vous connaissez ?
Peut-être pas, et pourtant ils valent le détour. Ce sont des espèces oubliées peuplant les haies et les bois, dont les fruits constituaient autrefois une friandise ou un complément alimentaire pour les hommes ou le bétail. Adaptés aux terroirs, ces fruitiers sont de culture facile, résistants aux parasites et donnent des fruits intéressants sur le plan nutritionnel. Certains fruits « sauvages » reviennent au goût du jour comme les cynorrhodons ou nous viennent d’autres pays et méritent d’être cultivés chez nous : c’est le cas des fruits du fuchsia rampant de Nouvelle-Zélande, ou encore des airelles, plus connues, mais originaires du continent nord américain.
La plantation
Où installer ces nouveaux venus ?
Tout dépend de l’espèce, bien sûr ; l’alisier fera un beau sujet en verger, ou isolé dans une cour ou dans une haie ; les airelles peuvent rejoindre les autres petits fruits, constituer une petite haie de séparation ou un arbuste structurant le jardin d’ornement ; le fuchsia rampant, excellent couvre-sol fleuri, participe naturellement au jardin d’ornement.
Ce qui importe : un endroit où le plant aura de la lumière et un sol adapté à ses besoins, une place en harmonie avec l’organisation du jardin. Ainsi, évitez le sureau noir près de la terrasse ou du fil à linge : les oiseaux laissent quelques traces de leur consommation des fruits sur leur passage.
Comment planter ?
En « deux mots » : respecter les règles de base suffit pour ces espèces assez peu exigeantes.
Le trou de plantation
Un cube de 50 cm de côté est souvent suffisant. Respectez les distances entre les arbres recommandées par le pépiniériste. Creusez sans mélanger les différentes couches de terre, il faudra les remettre dans l’ordre. Ne lissez pas et ne compactez pas le fond et les bords du trou. Rebouchez en répartissant bien la terre pour qu’il n’y ait pas de poche d’air entre les racines, tassez au fur et à mesure en ayant soin de bien positionner l’arbre. Celui-ci doit être droit, les racines bien orientées vers le fond et le point de greffe hors de terre.
La préparation des racines
Recoupez-les pour avoir une longueur homogène du système racinaire, pralinez-les avec du pralin du commerce ou fait-maison (mélange en quantité égale de bouse de vache et d’argile).
Les soins
Apportez de l’engrais lorsque le trou est rebouché aux 2/3 (engrais complet pas trop riche en azote + poudre d’algue riche en oligoéléments), arrosez copieusement, comblez entièrement le trou, arrosez à nouveau. Vérifiez le tuteurage et la position du point de greffe hors du sol.
Pourquoi planter des fruits sauvages ou oubliés ?
Pour appréhender des saveurs différentes, diversifier son alimentation, pour bénéficier des qualités nutritionnelles exceptionnelles de certaines espèces.
Citons quelques exemples :
- Les canneberges, riches en vitamines A et C, ont un apport en potasse, phosphore, magnésium et calcium intéressant, et sont souveraines en cas d’infections urinaires.
- Le cynorrhodon contient 30 fois plus de vitamine C que le citron.
- Les baies de goji, incontournables de la pharmacopée chinoise, sont riches en vitamines, antioxydants et minéraux…
- Les fruits de l’alisier ont des propriétés antidiarrhéiques de même que les nèfles et les cormes ; ceux de l’aubépine coupent la faim…
Les gourmands trouveront aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles recettes ou encore de chercher dans les archives des astuces de préparation… Ainsi, on valorise les cenelles (fruits de l’aubépine) plutôt sous forme de farine que sous forme de confiture !
Cultiver des fruitiers sauvages ou oubliés complète ou renforce la capacité du jardin à accueillir les pollinisateurs, et plus largement la faune locale – donc naturellement les auxiliaires, bien utiles au jardinier. Notons au passage que ces espèces sont souvent moins sensibles aux maladies et qu’elles ont des exigences de soins moindres également : la taille se limite à du nettoyage, pas d’éclaircissage…
Les jardiniers amateurs de greffes pourront trouver des ressources en porte-greffe pour le verger, pour peu qu’ils cultivent des merisiers, pommiers, poiriers ou pêchers, sauvages ou de semis, voire de l’églantier pour introduire quelques variétés de rosiers.
Les principales espèces à cultiver
La liste est longue et c’est tant mieux ! De plus en plus, les pépiniéristes proposent des espèces venues des quatre coins du monde dont la majorité est assez rustique. On peut distinguer les espèces « indigènes », les espèces acclimatées et les espèces plus frileuses, à réserver aux zones littorales ou méditerranéennes. Ajoutons quelques curiosités découvertes ou redécouvertes sous l’influence d’autres populations.
Comment se procurer ces plantes ?
Cherchez-les, non pas auprès des grandes enseignes de jardinerie, mais plutôt chez des pépiniéristes qui connaissent les vergers et les haies. Comptez de 5 à 10 euros, selon les espèces, pour un plant en motte de 20-30 cm ; si vous pouvez profiter de sujets plus grands, n’hésitez pas, c’est autant de temps de gagné pour la mise à fruits. La question du goût des fruits mérite d’être posée, il ne faut pas s’attendre aux mêmes sensations gustatives qu’avec les fruits que nous consommons habituellement ; il s’agit de fruits moins « goûteux », plus acidulés, et pour certains à consommer blets, frais ou cuits. Leur taille est aussi moindre et le noyau assez gros, en principe.
Les espèces indigènes
Vous avez le choix : alisier, aubépine (cenelle, fruit farineux), amandier, cognassier, châtaignier, églantier qui donne des cynorrhodons, framboise (Héritage et Fall gold), groseillier à grappes, groseillier à maquereaux, noisetier, pommier sauvage, prunier commun, prunier myrobolan, sureau… Il y aussi le cormier, le cornouiller, le néflier et le fameux prunellier du bord des chemins dont les fruits sont à consommer blets après une ou deux gelées. Ajoutons les pêchers de « vigne » ou autres, issus de semis.
Les espèces acclimatées
- L’argousier : en plantant plusieurs pieds, vous aurez des fruits. Ils sont orange vif au milieu d’épines ; cet arbre résiste aux embruns, se débrouille des sols salés et sableux pourvu qu’il y ait un peu de fraîcheur l’été ; on le nomme aussi épine de mer.
- L’aronie noire ou rouge, arbuste à feuilles caduques (craint le calcaire).
- La myrtille géante « Jersey » ; elle produit en août des fruits de grosse taille.
- La canneberge, qui craint la chaleur, est un couvre-sol de terrain acide ; elle produit les célèbres cranberries ou canneberges.
- Si vous avez un sol calcaire aéré, n’hésitez pas à cultiver le goji, vous récolterez d’août à octobre les fameuses baies, plutôt à utiliser séchées…
- Et aussi les airelles, les physalis, le ragouminier ou ceriser du Canada, l’amelanchier ovalis ou canadensis.
Les espèces plus frileuses
Si la température descend en dessous de – 10 °C, elles risquent de souffrir :
- l’arbousier, un arbuste méditerranéen (à rentrer par grand froid), qui donne des fruits orangés au goût délicat et sucré ;
- le maqui à feuilles panachées, dont la femelle produit des baies comestibles : plantez plusieurs sujets pour obtenir des fruits.
Un peu plus frileux :
- le goyavier de Montevideo qui supporte les sols salés, et dont les fruits ressemblent à des kiwis sans poil ;
- le goyavier du Chili qui craint l’humidité et le calcaire, et qui produit des murtillas, petites baies rouges à consommer frais.
Les créations ou les espèces curieuses
- La caseille « Josta », croisement de groseillier à maquereaux et de cassis, très productive dès 4 ans, fournit en juillet des fruits à consommer frais ; il y a un peu de taille à prévoir.
- La mûre-framboise ou muroise « Buckingham », très productive, est facile à cultiver sous réserve de la palisser.
- Le chèvrefeuille à baies bleues, « Lonicera kamtschatica », se plante en groupe et donne des baies bleues en mai ; attention, les baies de tous les autres chèvrefeuilles sont toxiques !
- Le fuchsia rampant, fuchsia procubens, est frileux (en danger en dessous de – 5 °C), mais il faut quand même essayer de le cultiver chez vous : vous aurez des fleurs originales vert-jaune et des fruits comestibles rouges pour l’automne !
La mise en œuvre
Comme pour toute installation de plante, il faut avoir une petite idée : du volume occupé au stade adulte, des périodes de floraison et, pour les fruitiers, de la période de fructification. En principe, les fruitiers sauvages sont autofertiles, cependant renseignez-vous, si ce n’est pas le cas, il faudra planter plusieurs sujets pour avoir une bonne pollinisation.
La haie, une belle valorisation des fruitiers sauvages
Pourquoi ne pas saisir l’occasion, en cette fin d’automne, de remplacer votre haie de cupressus, de laurier-cerise ou de persistants par une haie plus dynamique, source de biodiversité ? Les avantages de ce choix sont indéniables :
- Vous contribuerez au maintien de la biodiversité, ce qui concrètement pour vous veut dire : plus de faune, de faune auxiliaire, de pollinisateurs, et donc moins de risques sanitaires pour vos cultures.
- Vous disposerez, sur une période assez longue, entre 5 et 7 mois, de fruits variés et de qualité à cueillir.
- Vous contribuerez à la qualité paysagère de votre lieu d’habitat : floraison plus étalée dans le temps, des feuillages d’automne remarquables.
- Vous limiterez le temps, et sans doute le coût d’entretien de votre haie. La plupart des espèces fruitières sauvages ont des exigences culturales réduites, en eau, notamment, pour les espèces indigènes.
Pour avoir une « haie écran », il faut prévoir de planter les rares espèces fruitières à feuillage persistant (arbousier, Elaeagnus ebbengei, maqui à feuilles panachées, myrte) ou introduire quelques arbustes ornementaux (escallonia, if…). Attention de ne pas confondre les baies !
Voici quelques exemples d’assemblage d’espèces proposant une fructification étalée sur 5 à 7 mois selon les climats ; les périodes indiquées correspondent au moment de la cueillette.
| Exemple de haie haute | – Juin-juillet : merisier – Août : argousier, franc mirabellier Septembre : arbousier, cormier, prunier myrobolan – Octobre : alisier, néflier – Novembre : châtaignier, kaki, cormier. |
| Exemple de haie moyenne | – Juin-juillet : amélanchier ovalis, goyavier du Chili – Août : aronie rouge, goji – Septembre : goji, églantier sauvage – Octobre : goji, noisetier, pommier sauvage – Novembre : goyavier de Montevideo. |
| Exemple de haie basse | – Mai : chèvrefeuille bleu – Juin-juillet : framboisiers (variété « héritage », par exemple) – Août : aronie noire, aronie rouge, groseillier à maquereaux, myrtille géante de Jersey – Septembre : myrte, aronie noire, aronie rouge, caseille – Octobre : mûre ronce… |
| Exemple de couvre-sols fruitiers | – Juin-juillet : fraises des bois – Août : physalis – Septembre : airelles, canneberge, physalis – Octobre : fuchsia rampant… |