Changer ou disparaître
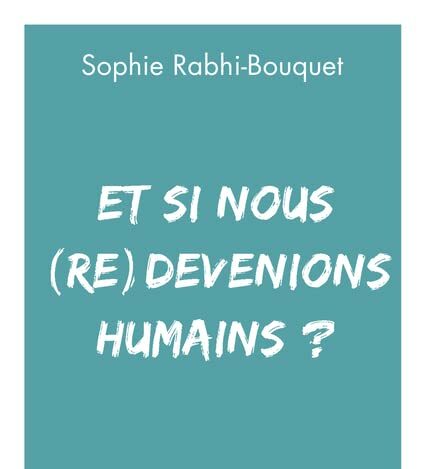
L’avenir de la planète et de ses habitants semble bien sombre et sans rien changer à nos comportements, c’est sûr, on va droit dans le mur… Les enjeux sont immenses et imposent des changements drastiques. Dans son ouvrage, Sophie Rabhi-Bouquet nous invite à « considérer les motivations profondes qui guident nos actes, les stratégies que nous utilisons pour assouvir nos besoins et les possibilités dont nous disposons pour développer d’autres moyens que la violence ». Tout un programme ! Partant de l’hypothèse que la violence n’est pas innée, mais acquise (neurosciences à l’appui), l’autrice propose que nous puisions dans l’inépuisable gisement de bienveillance et de bientraitance qui nous habite (même s’il est un peu enfoui parfois…) pour renouer avec notre fonction première : celle de « donneur de soin ».
Et si nous (re)devenions humains ?
Sophie Rabhi-Bouquet, Éditions Actes Sud, 10 x 19 cm, 218 pages, 18 €.



