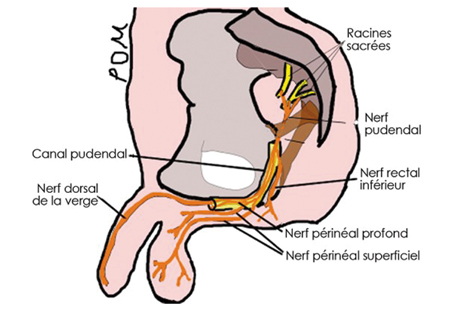Faux positifs et faux négatifs, ou la limite de la fiabilité des tests médicaux
Parler de faux positifs ou de faux négatifs revient à parler de la sensibilité ou de la spécificité des examens médicaux. Autrement dit, des erreurs de diagnostic.
Le risque zéro n’existe pas, surtout en médecine qui reste une science humaine soumise aux aléas des humains qui la pratiquent, mais aussi à la technique. C’est le cas, par exemple, des tests médicaux et autres examens complémentaires comportant des faux positifs et des faux négatifs qui viennent souvent compliquer le diagnostic. Quant aux vrais positifs, ils correspondent aux tests positifs à une maladie avérée par un autre test (examen de sang et biopsie, par exemple). Les vrais négatifs correspondent, eux, à la meilleure des situations : un test qui revient négatif et l’absence avérée de maladie.
Un faux positif, c’est quoi ?
Un faux positif est un examen qui s’avère positif à une maladie… en l’absence de la maladie en question ! Ce sont des gens non malades avec un test positif. C’est le cas, par exemple, de certains tests de dépistage qui donnent un résultat positif, alors qu’un autre test vient l’infirmer.
- Dans le cas des mammographies, certaines images peuvent évoquer un cancer finalement non retrouvé lors de l’intervention chirurgicale ou de la biopsie. Selon une étude, sur 1000 femmes traitées pour un cancer, 13 d’entre elles le seraient pour un cancer qui n’existe pas. D’où l’importance de toujours recouper l’information, en renouvelant le test, en pratiquant un autre examen complémentaire, et en faisant interpréter la mammographie par un deuxième radiologue, comme le prévoit, d’ailleurs, la législation.
- Le faux positif le plus classique est l’effet « blouse blanche » dans lequel le patient présente une hypertension artérielle lorsque c’est le médecin qui prend la tension, alors que celle-ci s’avère normale lorsque c’est le patient qui la prend au moyen de son tensiomètre personnel.
Pour lire la suite
Fondé en 1998 par Sophie Lacoste, journaliste passionnée par les plantes et leurs bienfaits, Rebelle-Santé est un magazine totalement indépendant. Chaque article est soigneusement rédigé par humain spécialisé dans le sujet. Rebelle-Santé ne pratique pas la publicité déguisée.
En vous abonnant, vous recevrez chez vous 10 numéros par an et 1 à 4 hors-séries. Vous aurez également accès à plus de 11 000 articles et à 45 nouveaux articles chaque mois.
Comme tout média indépendant, Rebelle-Santé a besoin de vos abonnements pour continuer à exister.
Déjà abonné·e ?